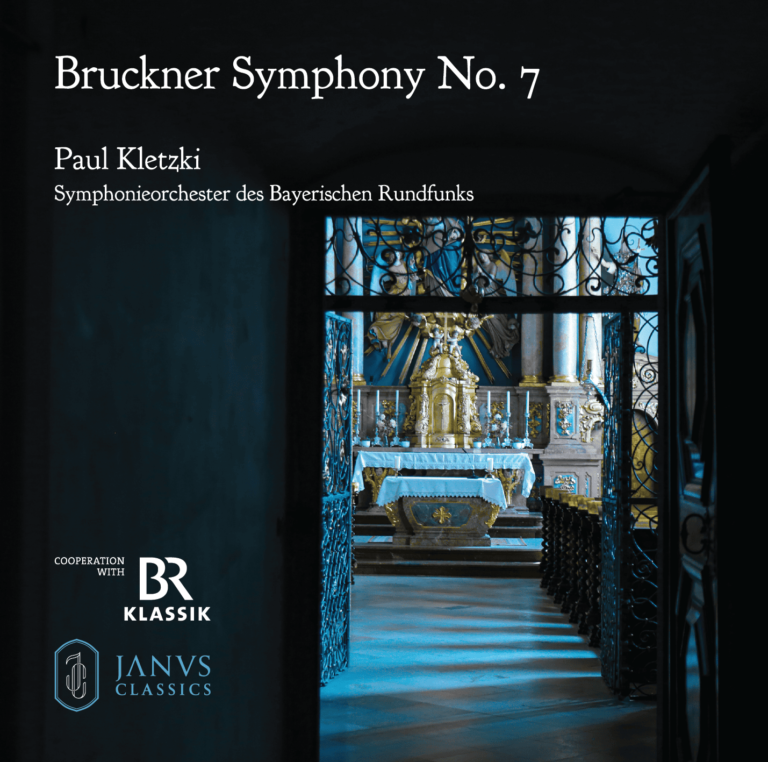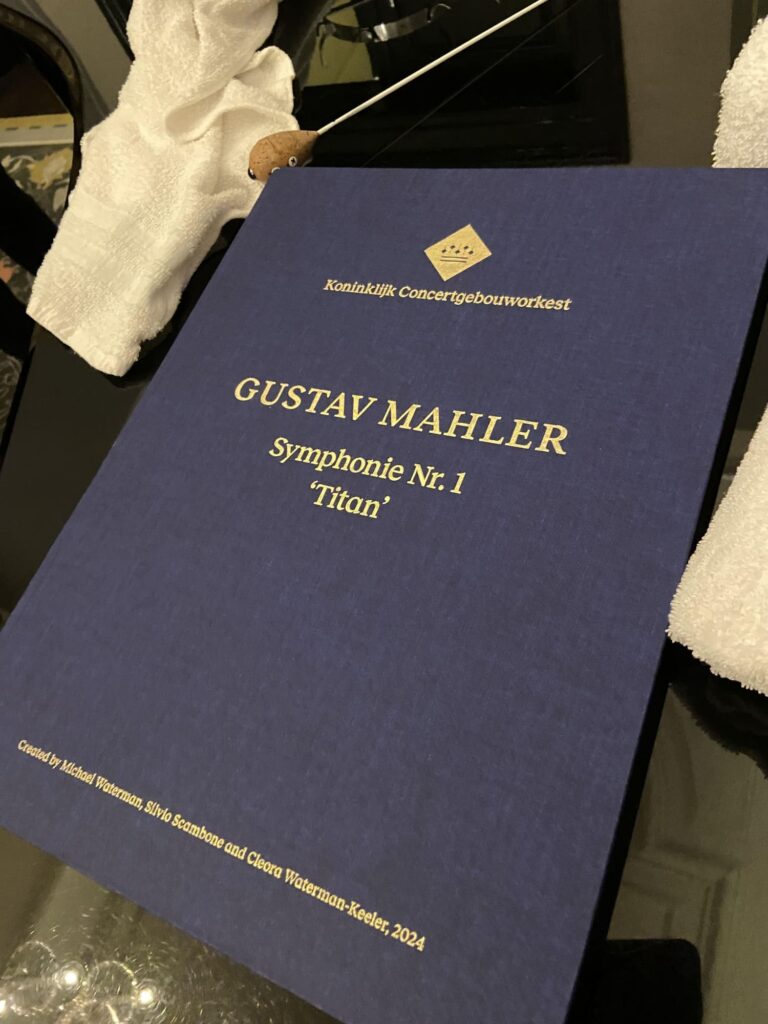Date et lieu : 20 juin 2024, Het Concertgebouw d’Amsterdam
Chef d’orchestre : Manfred Honeck
Orchestre : Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam
Programme :
Anton BRUCKNER, Symphonie n°8 en ut mineur
Le 2 octobre 1920, l’Orchestre du Concertgebouw donna la première néerlandaise de la Huitième symphonie de Bruckner. Dans l’un des journaux, la performance fut qualifiée de « splendide » ; dans un autre, le critique nota que « de nombreux spectateurs quittèrent la salle avant le finale ». Le temps n’était pas encore venu pour Bruckner. Ce n’est que dans les années 1950 que le Maître de Saint Florian devint le fer de lance de la prestigieuse phalange amstellodamoise et que tous ses chefs titulaires se firent un devoir d’inscrire Bruckner à leur répertoire. En cette année du bicentenaire de la naissance du compositeur autrichien, chacune des 9 symphonies (on pourra regretter l’absence des symphonies 0 et 00) est confiée à un chef différent. Et pour ce premier jour d’été, c’est Christian Thielemann – malheureusement souffrant – qui devait s’illustrer dans la Huitième. C’est Manfred Honeck qui dut le remplacer au pied levé. Le chef autrichien a déjà gravé deux très belles interprétations saluées par la critique des Quatrième et Neuvième symphonies avec son orchestre de Pittsburgh.
La Huitième symphonie, en ut mineur, composée entre 1884 et 1892, dernière œuvre d’envergure achevée par Bruckner, est l’une des partitions les plus importantes du répertoire symphonique. Ce chef-d’œuvre, souvent décrit comme une « cathédrale musicale », est censé incarner la profondeur religieuse et la complexité émotionnelle du compositeur. Manfred Honeck propose ce soir une magistrale interprétation de cette symphonie superlative, sorte d’apothéose de l’art symphonique européen de la fin du XIXe siècle.
Dès les premières notes, le son plein et chaleureux si caractéristique du RCO enveloppe la salle. La symphonie s’ouvre sur le drame de doute, mais rapidement, la sensualité imprègne l’œuvre avec des réminiscences de berceuse. Manfred Honeck choisit un tempo ample, permettant au thème au hautbois, qui annonce déjà le premier mouvement de la Neuvième symphonie, de se développer pleinement. Les cordes, d’une tenue exceptionnelle, du début à la fin du concert, offrent des pianissimi d’une rare finesse, alternant entre doutes et affirmations toujours dans une clarté époustouflante.
La suspension du temps dans le solo du cor, auquel répond le hautbois, est magistrale. Honeck sait étirer les moments sans lourdeur, laissant les questions de Bruckner résonner avec une clarté inouïe, dans des plans sonores finement exposés. Il révèle l’étagement des thèmes, jouant sur les contrastes, adret et ubac en ce jour de solstice d’été, cultivant un hédonisme sonore rendu possible par son prodigieux orchestre. Mais ce n’est jamais gratuit : la main gauche de Honeck, douce et expressive, nous offre une vision autant biographique (les atermoiements de la foi de Bruckner) qu’historique (le ciel de l’Europe qui s’obscurcit).
La fin du premier mouvement est particulièrement saisissante : proprement inouï, il est joué comme un cœur qui cesse de battre peu à peu jusqu’à l’extinction. Le silence et la concentration du public sont d’une intensité rare.
Le deuxième mouvement prend une tournure différente avec un scherzo dédramatisé, contenant néanmoins quelques éléments d’inquiétude. Honeck ralentit soudainement le tempo, prenant le temps de sonder, de sculpter, et d’ausculter les palpitations et les intermittences du cœur. Puis, un nouveau thème apparaît : presque une valse, avec des harpes aux sonorités de célesta, suivies par le silence et le retour au questionnement, toujours avec ce même sens du ralentissement sensuel. On a rarement entendu quelque chose d’aussi « viennois » dans ce scherzo, loin des Ländler mahlériens de la Troisième symphonie. Honeck sait tout ce que Bruckner doit à Schubert : c’est une interprétation généreuse, le cœur sur la main, intime dans son gigantisme, géante dans son intimité, touchant ainsi à l’universel.
La réexposition du motif A procède par vagues sonores, dans ce scherzo plus élégant et apaisé que sardonique. L’orchestre se distingue par l’excellence des cuivres, le frémissement des cordes, et l’usage de rallentendos d’une grande justesse, qui ont un sens profond et parfaitement intégré à l’interprétation.
Avant de commencer l’adagio, en ré bémol majeur, Manfred Honeck attend de longues secondes, comme si, pour paraphraser une célèbre boutade, le silence qui précède Bruckner était déjà du Bruckner. L’adagio vibre subrepticement avec l’émotion retenue du Quintette en ut de Schubert, dont il est ici le descendant, imposant une gravité tendre et des moments de pure émotion. Honeck sait faire respirer l’orchestre, laissant parler l’évidence de la musique. Il fut l’assistant du regretté Claudio Abbado, on sent son influence dans cette interprétation : l’attention aux pupitres, au service de la seule musique.
C’est le temps des regrets crépusculaires, aussi, dans cet adagio aussi grave que réconfortant, tendre, jamais pathétique, très noble et toujours humble. Honeck incarne cette musique avec une hauteur de vue impressionnante, creusant le silence d’une manière qui rappelle autant Abbado que Celibidache. Le violon solo par lequel se termine le mouvement se distingue de manière très audible, et Honeck maintient l’intérêt tout au long de ce mouvement de près d’une demi-heure, considéré comme l’un des plus beaux adagios de l’histoire. Des moments d’hypnotisante transcendance jalonnent ce passage, faisant de la Huitième une symphonie du temps, et sur le temps. Il faut entendre ces pizzicati qui égrènent les secondes et qui révèlent un Bruckner humain, jamais bruyant ou trop mystique.
En maître du temps, précisément, Honeck propose une synthèse humaniste, chaleureuse, humble, spirituelle et réfléchie de l’œuvre : tout y est ! La fin, wagnérienne (les tubas !) aux accents de l’Or du Rhin, donne une clé de compréhension : comme Alberich, Bruckner a renoncé à l’amour pour forger un autre anneau, celui de la musique et de l’art, sublimant les turpitudes de la chair : « tu m’as donné de la boue et j’en ai fait de l’or », alchimiste des notes.
Le dernier mouvement, souvent attendu comme un climax triomphal, ou une « bataille des démons », ne verse jamais dans le spectacle de la grande cavalcade. Honeck, usant d’un tempo soutenu, en fait une continuité avec le mouvement précédent. À la fois chthonien, aquatique et aérien, ce mouvement représente une symphonie élémentaire, parsemée de quelques ultimes embrasements crépusculaires.
Cet ultime soubresaut concentre les effets, c’est le moment des résolutions, tout en laissant parfois entendre encore quelques échos de l’Or du Rhin. La coda arrive, conforme aux attentes de Bruckner, avec un mouvement impressionnant de calme grandiose qui n’est pas sans rappeler l’Inachevée de Schubert. C’est l’acceptation mélancolique mais rassérénée de la vie telle qu’elle est, les portes grandes ouvertes sur l’éternité. Standing ovation immédiate et méritée !
Au cours de ce parcours symphonique, acmé de la symphonie européenne du XIXe siècle, on est ainsi passé des gouffres aux cimes, des blessures herculéennes aux guérisons chironiennes, dans un cheminement labyrinthique dont Honeck dessine les contours cathartiques. Ce portrait d’un homme humble et d’une Europe qui peut basculer et chavirer à tout instant rappelle Stefan Zweig. La Vienne insouciante s’apprête à être bouleversée et psychanalysée. La coda régénératrice et doucement résignée permet néanmoins de faire triompher les lumières de l’espérance.